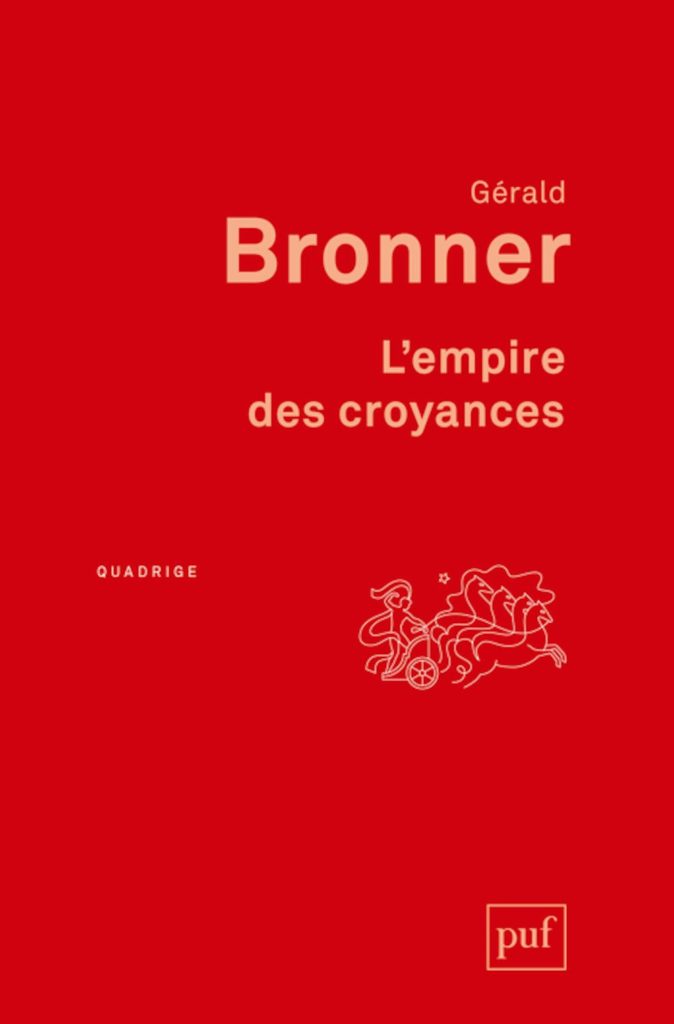
Fiche de lecture : L’empire des croyances, de Gérald Bronner
Sur l’auteur : Gérald Bronner est un professeur de sociologie à l’université de Paris et membre de l’institut universitaire de France. Il travaille notamment sur des questions autour des croyances et de la radicalité. Parmi ses ouvrages les plus connus, on retrouve La pensée extrême (Denoël, 2009), La démocratie des crédule (PUF, 2013). L’empire des croyances est publié en 2003, chez PUF.
Référence bibliographique : Bronner Gérald (2003), L’empire des croyances, PUF, Coll. Quadrige, Paris, 2019.
Sur l’auteur : Gérald Bronner est un professeur de sociologie à l’université de Paris et membre de l’institut universitaire de France. Il travaille notamment sur des questions autour des croyances et de la radicalité. Parmi ses ouvrages les plus connus, on retrouve La pensée extrême (Denoël, 2009), La démocratie des crédule (PUF, 2013). L’empire des croyances est publié en 2003, chez PUF.
L’auteur débute son ouvrage, qui est une sorte de prélude à La démocratie des crédules, en rappelant que la croyance est une caractéristique typiquement humaine qui est présente tout au long de l’histoire. Le constat est simple : malgré les progrès cumulatifs de la connaissance, et même si ces derniers ont pu faire disparaître une multitude de croyance, de nouvelles continuent d’émerger, alors même que le monde est traversé par un flux informationnel sans équivalent dans l’histoire de l’humanité. Voilà ce qu’est l’empire des croyances. Tout l’objet de l’ouvrage est donc de resituer les croyances, ce qui est résumé ici en trois axes : l’articulation entre connaissance et croyance, la formation des croyances individuelles, la transition de la croyance individuelle à la croyance collective.
L’articulation entre connaissance et croyance
Bronner entreprend, en premier lieu, d’expliciter le rapport entre connaissance et croyance. Autrement dit, se positionner sur la question du vrai et du faux. En contextualisation son raisonnement dans une histoire philosophique des idées non-exhausive et en s’inspirant de Platon, Kant et Hume, il développe une perspective qui servira de base à la suite de son travail. Sans tomber dans le relativisme, il explique qu’une croyance se définit par son contenu, c’est-à-dire son bien-fondé en fonction des éléments objectifs, et par le rapport que les individus entretiennent avec ce contenu, autrement dit la nature de leur argumentation. Un acteur affirmant que la terre est ronde mais sans pouvoir expliquer efficacement comment il peut l’affirmer est plus croyant que connaissant. Croyance et connaissance ne sont donc pas fondamentalement opposées selon l’auteur, mais la connaissance objective reste une catégorie particulière de la croyance qui tend vers le vrai en terme de probabilité et est défendue par une argumentation solide, appuyée par des éléments du réel, là ou une superstition est une croyance avec peu d’argumentation qui tend probablement vers le faux en ce que peu d’éléments du réel permettent de la valider.
Mais la véritable pierre angulaire de cette distinction croyance-connaissance, selon Bronner, est l’information, dont la carence rend possible la croyance. Or, dans notre société de l’information, il ne semble pas incohérent de penser que la connaissance supplantera tôt ou tard la croyance. Pourtant, l’auteur indique qu’il est possible que les croyances ne disparaissent jamais. Une situation paradoxale apparaît à ses yeux : les progrès de la connaissance n’annihile pas les croyances mais les rendent polymorphes. Rien d’étonnant alors qu’à mesure que le domaine de la connaissance croît, celui de la croyance ne décroît pas. Ce que la métaphore de la sphère de Pascal explicite bien : La connaissance, contenue dans une sphère, ne fait que grandir. Sa surface suit le mouvement, et se faisant, entre en contact avec un champ toujours plus élargi de ce qui est inconnu. Le constat est donc sans appel : la science, fer de lance de la connaissance, ne peut réduire la croyance au néant, en ce qu’elle participe elle même à L’empire des croyances. L’apport de connaissances crée des interrogations nouvelles et ouvre un champ des possibles. La démarche scientifique ne peut, de plus, éclairer certains questionnements métaphysiques. Enfin, basé sur des connaissances techniques complexes, son contenu peut aisément être mal interprété.
Cependant, il en reste que la sphère de la connaissance progresse, et que la recherche de l’objectivité a permis aux humains de s’extraire des visions égocentriques les éloignant d’une certaine réalité. Cette « décontextualisation de la rationalité » (p.164) rend possible une meilleure compréhension des phénomènes. Bronner fait ici un lien avec le « désenchantement du monde » (ou « démagification ») de Max Weber, cette notion sociologique clé selon laquelle les explications mécaniques, techniques, scientifiques ont peu à peu supplanté les explications magico-religieuses, menant ainsi à une crise du sens génératrice d’incertitude et donc de croyance, puisque répondre au comment ne permet pas de répondre au pourquoi.
La formation des croyances individuelles : décalage entre perception extérieure et rationalité
La distinction étant établie, le sociologue poursuit sur la question de l’émergence des croyances individuelle. « Toute l’ambition d’une sociologie des croyances sera de reconstruire les logiques qui concourent à l’émergence de ce type d’adhésion cognitive, en voyant qu’elles sont, par définition, entachées par les limites même de la rationalité individuelle » (p.24). Car c’est bien la possibilité de l’erreur qui garantit l’autonomie. Un individu omniscient n’est pas libre, ou pour le dire autrement, face à une information parfaite et totale, il ne choisit pas, car l’information le fait pour lui. « L’imperfection de la conscience individuelle est la condition d’existence de la croyance et participe de notre identité d’acteur social autonome ». Ainsi, l’individu croyant ne peut être perçu d’emblée comme irrationnel, ce qui implique de s’interroger sur la notion de rationalité. Alors, dans les pas de Max Weber et Raymond Boudon, s’opposant à une conception restreinte utilisée dans les paradigmes holistes et en économie, Bronner défend une conception ample de la rationalité, basée sur une compréhension Weberienne, qui replace la rationalité dans un contexte culturel et social et accorde une place aux valeurs individuelles et à l’intentionnalité. Si, de prime-abord, les croyances extérieures peuvent sembler irrationnelles, c’est qu’elles sont opaques. Le sociologue explicite trois « opacités de la croyance » (p.40) : 1) les individus ont tendance à appliquer leurs propres catégories de pensée aux autres, alors même que ces derniers répondent à d’autres catégories. Il y a en fait une distance culturelle ; 2) l’adhésion à une croyance n’est pas nécessairement inconditionnelle, même lorsqu’elle s’exprime en acte. Un rapport à la croyance peut tout à fait être probabiliste, en fonction des coûts et des bénéfices. Un joueur de loto n’a pas la certitude de gagner, mais il a bien plus à gagner qu’à perdre en jouant. ; 3) la croyance est graduelle, c’est-à-dire que l’adhésion a une croyance peut être issue d’un processus construit invisible pour l’observateur extérieur confronté à la croyance finalisée. Ces opacités tendent à rendre plus difficile la perception des croyances qui répondent en fait à une rationalité subjective individuelle . Pour autant, peut-on dire que toutes les croyances relèvent de la rationalité ? Bronner répond à cette question en éludant le rapport entre croire et vouloir. Les thèses utilitaristes de Tomas Ibanez et Léon Festinger considèrent que les individus ajustent leurs croyances à leurs actions pour éviter que ces dernières entrent en contradiction avec leurs systèmes de représentation, ce qui les mèneraient à une dissonance cognitive. Sous leurs plumes, le croire est relié au vouloir, permettant une « immunologie idéologique » (Edgard Morin, cité p.72) rendant presque inutile toute argumentation face à un convaincu. Pour Thomas Khun, l’abandon d’une croyance ancienne nécessite l’adoption d’une nouvelle pour pallier à l’incertitude et à l’insécurité provoquées par la perte. Ce qui fait dire à Bronner que les individus entretiennent des rapports d’intérêt à leur croyance, autrement dit, elles s’enrichissent d’une notion d’utilité qui vient combler ou supplanter l’argumentation. Il précise, cela dit, que l’argumentation a une plus grande importance dans la diffusion des croyances (le « croire » pèse plus que le « vouloir ») en ce que la réalité peut dénier à répétition la croyance infondée. Au regard de ce qui a été dit précédemment, il s’agit désormais de comprendre ce qui fait des êtres des croyants. Puisque chaque individu répond à une rationalité subjective, Bronner entreprend d’expliquer les éléments qui empêchent les acteurs d’atteindre l’omniscience. La rationalité est en fait limitée de trois manières.
En premier lieu, l’être est limité dimensionnellement. Les limites sensorielles empêchent de percevoir au delà d’un espace restreint, constituant en soi une limite à la quantité d’information qu’il est possible de percevoir, quand bien même l’information est disponible à profusion de nos jours, ce que Bronner souligne en fin d’ouvrage. Les êtres évoluent, de plus, dans un ensemble de sphères sociales et géographiques qui filtrent le nombre et le type d’information qu’ils vont recevoir. Également, les acteurs sont ancrés dans le présent, alors même qu’une part de leur interrogations portent vers le passé, dont les connaissances sont limitées ou vers le futur, qui est un objet d’angoisse. La vie sociale est fondée sur un ensemble d’anticipations plus ou moins inconscientes, participant à la stabilité sociale, en ce qu’elles fonctionnent comme des prophéties autoréalisatrices dès lors qu’une multitude d’acteurs y adhérent. Elles impliquent l’idée que le futur sera similaire au présent, ce qui est bien sur faux, mais qui est induite par les typifications particulières que les individus appliquent à leurs vies quotidiennes (en prenant le bus, si les référents essentiels sont le coût et le trajet, des éléments stables sur le long terme, alors un sentiment de similarité peut s’installer). Le temps, encore, a une largeur, selon Bronner. C’est ce moment où s’ouvre, face à une incertitude, une dimension des possibles dans laquelle l’ « intuition probabiliste » (p.94) est le seul outil de perception et de déplacement des sujets en fonction de leurs intérêts propres.
En second lieu, ces limites sont culturelles. Les croyances répondent à nos système de pensée et de représentation. Même lorsque les agents sont en possession de l’information, elle doit encore passer par le filtre des représentations, loin d’être neutre et qui participe à la déformation d’information. La culture s’apparente ici à une « réserve pré-organisée de connaissances » (p. 117) qui joue un double rôle paradoxal : permettre d’avoir une préhension du monde et pouvoir déformer la réalité à laquelle chacun est confronté. En d’autres termes, un système de représentation peut inspirer des hypothèses afin de solutionner un problème cognitif qui feront émerger de nouvelles croyances ou il peut déformer une information et ainsi créer un espace entre l’individu et la réalité où peuvent apparaître des croyances, comme l’idéologie peut le faire en déformant une information pour mieux l’adapter à des représentations ancrées.
En dernier lieu, le cerveau est limité cognitivement, il ne peut tout percevoir, tout comprendre et est l’objet de nombreux biais. Bronner montre ainsi comment les agents sont biaisés par leurs perceptions des probabilités conjonctives et disjonctives et des représentations erronées du hasard. Ainsi, les croyances ne sont pas sans logique mais cette logique se meut dans un espace de la rationalité triplement limité.
La théorie du marché cognitif et l’articulation des croyances individuelles et des croyances collectives
A la lumière des éléments précédents, il s’agit désormais pour Bronner d’opérer la délicate transition entre croyances individuelles et croyances collectives. A l’inverse de tout un pan de la sociologie défendant la prévalence d’une entité supérieure productrice de norme et percevant donc les croyances collectives comme des produits coercitifs qui s’imposent aux individus de manière relativement homogène, Bronner, plus proche de l’individualisme méthodologique, analyse les croyances du point de vue des individus et de leurs interactions. Selon lui, les croyances ne sont pas tant homogènes et similaires que comparables. Puisqu’en effet, elles sont suffisamment similaires pour se transmettre mais les différents filtres vues antérieurement en font des objets particuliers, que seule l’observation et l’analyse des uniques sujets en présence peut révéler. C’est ici qu’il développe donc l’apport principal de son ouvrage : la théorie du marché cognitif.
Le marché cognitif est une métaphore évidente du marché économique qui en reprend certains principes que Bronner applique au champ des croyances. C’est le lieu où se font les échanges, les transactions entre offre et demande au travers des interactions des individus. Les croyances n’existent que dans l’esprit des acteurs et elles ne trouvent une place sur ce marché cognitif que si elles sont l’objet d’une relation, d’une transaction. Chaque individu n’aura qu’un accès restreint à ce marché en fonction des variables sociales et géographiques qui le concernent.
Les croyances peuvent être en différents états : monopole, oligopole ou concurrence. La situation la plus courante étant l’oligopole, c’est-à-dire qu’une croyance est dominante face à d’autres croyances minoritaires sur le marché cognitif. Dans tous les cas, l’adoption d’une croyance implique deux coût : l’un social, lorsqu’il s’agit de contester une doctrine officielle dominante, d’autant plus que les individus semblent avoir un attrait pour le conformisme, comme l’indique l’auteur ; l’autre cognitif, qui suggère la difficulté d’abandonner une croyance au dépend d’une autre et la remise en cause d’une représentation du monde. Ainsi, plus une croyance est partagée, plus son coût est faible : la loi de l’offre, contrairement à la loi de la demande, est valable sur ce marché là.
La fixation des prix renvoit aux facteurs qui font qu’une croyance aura des chances de parvenir à une position avantageuse sur le marché cognitif. Un de ces facteurs est la crédibilité du médiateur, celui qui partage une croyance. Cette crédibilité s’articule autour de trois axes : l’affectif, l’affection portée au médiateur augmente la crédibilité dont il jouit ; la compétence, si le médiateur paraît compétent, si il bénéficie d’un certain prestige, il paraît plus crédible ; l’intérêt, le médiateur a t-il un intérêt à faire passer tel message, remettant alors en cause sa bonne volonté ? Ce message est un autre facteur, dans sa forme mais surtout dans son fond. Il doit générer un « effet d’implication » (p.225), c’est-à-dire générer de l’envie d’être écouté, cru, repris, diffusé, en impliquant le récepteur. Tout aussi nécessaire, il doit participer d’un « effet de dévoilement » (p.229) permettant de rationaliser des éléments disparates et d’apporter une certaine satisfaction dûe à la compréhension d’un phénomène. Le récepteur pourra alors taxer ou non un produit cognitif en fonction de son système de représentation et des limites de sa rationalité, c’est-à-dire l’adopter intégralement, partiellement ou le rejeter. Mais ce qui est convaincant n’est pas toujours vrai. C’est qu’en somme, l’argument sous-jacent d’une croyance est sa condition nécessaire d’émergence sur le marché cognitif. Un récit peut paraître crédible pour des raisons multifactorielles, il devra toujours avoir une argumentation minimum pour se diffuser sur le marché cognitif, même si la structure de l’argumentation s’éloigne de la rationalité pure.
Cependant, si la loi de l’offre et les précédents éléments permettent d’expliquer comment un produit cognitif parvient à une position avantageuse sur le marché cognitif, elle ne permet pas de comprendre comment il a émergé sur ledit marché. C’est que, selon Bronner, le marché cognitif répond à une logique Darwinienne. Il s’oppose ainsi aux théories fonctionnalistes et Lamarckiennes. Ainsi, certaines croyances ne persistent pas parce qu’elles s’adaptent au fil du temps, elles persistent car elles étaient déjà plus adaptées aux conditions extérieures de leurs diffusions avant que l’observateur ne les regarde. Le processus de sélection a déjà eu lieu, en réalité et le contenu de la croyance est d’emblée prêt à consommer.
La conclusion de l’ouvrage offre une ouverture vers La démocratie des crédules, publiée dix ans plus tard. Ainsi, en reprenant les conclusions d’Emile Durkheim et Marcel Mauss, Bronner estime que les représentations collectives participent à la stabilité et à la régulation des systèmes sociaux. Mais à mesure que s’opère la distinction du travail intellectuelle, que se répand d’autant plus une spécialisation, que la diversification culturelle augmente, le maintien d’une cohérence stabilisante devient problématique car le marché cognitif tend à se libéraliser de plus en plus face aux vastes flux informationnels. Cette balkanisation des idées (p.265) tend alors à réduire la légitimité de la parole officielle.
